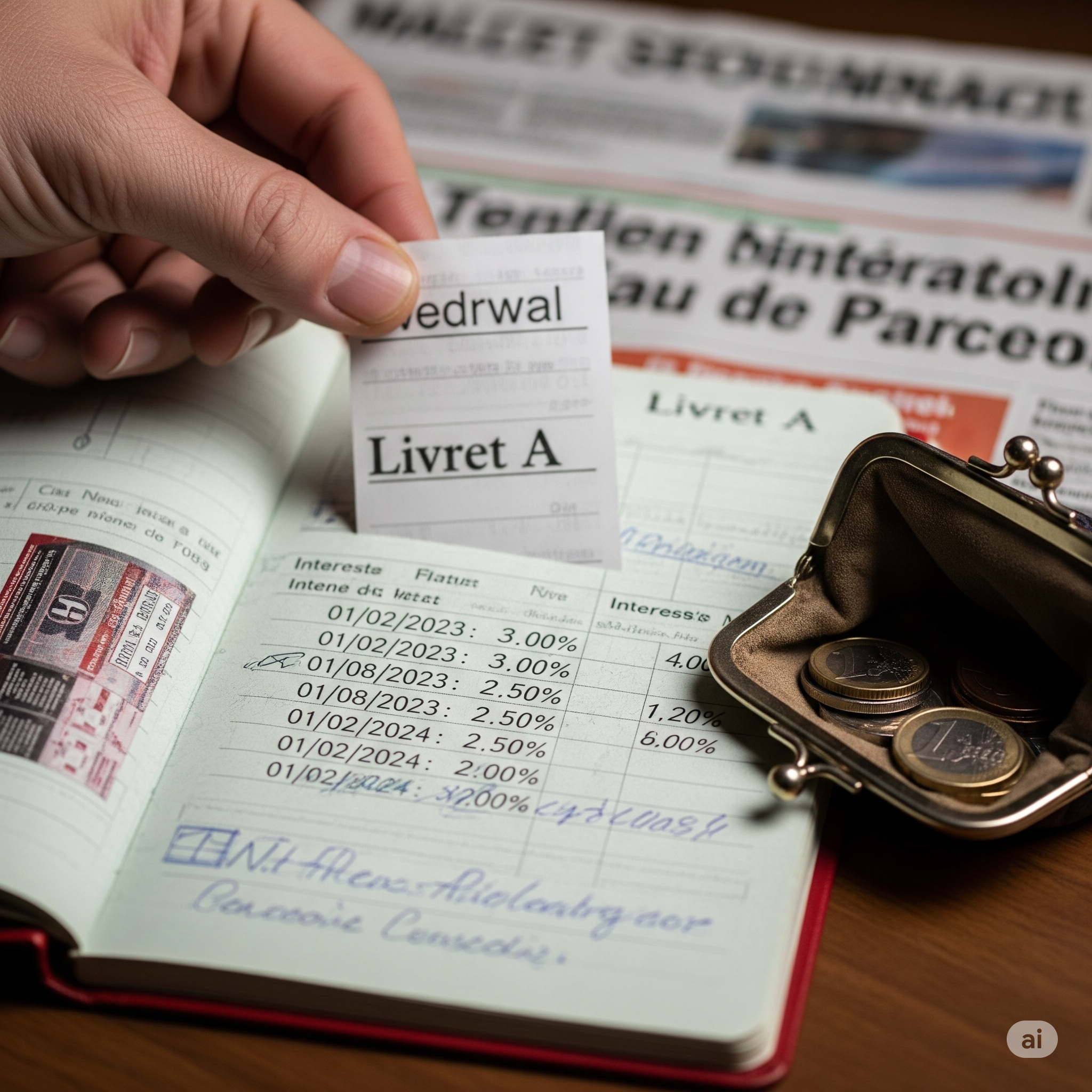Vous êtes professionnel libéral et exercez en nom propre. Pris par le rythme soutenu de votre activité, vous avez rarement l’occasion de lever la tête et de prendre du recul. Pourtant, une fois par an, un événement vient opportunément marquer une pause : la déclaration d’impôt sur le revenu.
Aussi contraignante soit-elle, cette formalité fiscale vous oblige à revisiter les chiffres de votre exercice, ceux que votre comptable vous a transmis. Elle dresse, parfois brutalement, le bilan de ce que vous avez gagné à la sueur de votre front… et de ce que vous allez rendre à l’État.
Car au-delà du chiffre d’affaires ou du bénéfice, la déclaration vous rappelle qu’une partie substantielle de vos revenus s’évapore sous forme de prélèvements. Et face à cette réalité, une question revient souvent : n’existerait-il pas un moyen d’optimiser ma rémunération ? Ai-je choisi le bon statut pour exercer mon activité ?
C’est un sujet que vous avez peut-être déjà abordé avec votre comptable, lequel vous a suggéré – ou non – d’envisager l’exercice en société (SAS, SELARL, etc.). À défaut, ce sont souvent des échanges entre confrères qui remettent cette idée sur la table. Les opinions divergent, les cas diffèrent, et, faute d’arbitrage clair, le sujet est bien souvent remis à plus tard… jusqu’à l’année suivante, et ainsi de suite.
Mais concrètement, que signifie exercer en société, et quels en sont les avantages réels ? Abordons ce sujet en synthétisant les points de vigilance et les principales questions à se poser.
Ce qui est valable pour votre confrère ne l’est pas forcément pour vous : Rappelons qu’il n’existe aucune solution miracle duplicable à tous les professionnels libéraux.
Transposer une étude réalisée pour un médecin à un avocat serait une hérésie. La réflexion doit en effet prendre en considération l’activité exercée, votre âge ainsi que vos objectifs.
Il est d’ailleurs essentiel de prendre de la hauteur et de réaliser une analyse globale, en prenant en compte les conséquences sur l’aspect professionnel et sur l’aspect personnel.
Rappelons les conséquences d’un exercice en nom propre : vous exercez juridiquement sous le statut d’entreprise individuelle. Vos revenus d’activité, dénommés Bénéfices Industriels et Commerciaux, sont globalement soumis à l’impôt sur le revenu en fonction des tranches marginales d’imposition ainsi qu’aux cotisations sociales.
Les tranches les plus lourdes, 41% et 45% sont respectivement atteintes à partir de 83824€ et 180 294€ (barème 2025).
La perception d’un revenu exceptionnel, ou le développement de votre activité peuvent rapidement vous conduire à ces tranches.
Problématique : vous ne pouvez pas maîtriser votre revenu ; chaque euro encaissé sera imposé, que vous l’ayez utilisé ou non.
Dans ce cas précis, l’argument principal en faveur d’une société est son rôle de tampon entre les bénéfices réalisés par votre activité et le revenu que vous allez vous verser.
Un exemple très synthétique : votre train de vis nécessite 100 000€ par an, le résultat de votre activité en 2025 est de 300 000€. En exerçant en nom propre votre impôt sera calculé sur la base de 300 000€. En société, vous pourriez tout à fait retirer un revenu de 100 000€. Les 200 000€ restant demeurent sur le compte de la société et ne sont donc pas soumis à l’impôt sur le revenu sur l’année considérée.
Cette souplesse dans l’ajustement de votre rémunération peut être un véritable atout.
Alors pourquoi tant de réflexion nécessaire sur l’intérêt d’opter pour l’exercice en société ?
Quelques grains de sable à prendre en compte : impôt sur les sociétés, frais, protection sociale, conséquences de la cessation de l’exercice libéral et questions relatives à la vente ou l’apport de la clientèle à la société, mode de rémunération (dividende ou salaire).
Nous l’avons vu, la société permet une distinction parfaite entre les bénéfices générés et les revenus que vous tirerez à titre personnel. Cette étanchéité nécessite de définir comment vous allez vous rémunérer : la société vous versera-t-elle un « salaire » (BNC) ou tirerez-vous des dividendes ?
Outre l’aspect social (questions relatives au prélèvements sociaux), la différence se situe aussi dans le traitement fiscal de ces deux modes de rémunération. Le versement d’un « salaire » est déductible du résultat de l’entreprise (mais vous soumet à la tranche marginale d’imposition) à la différence des dividendes qui sont donc taxés une fois à l’impôt sur les sociétés et une fois au prélèvement forfaitaire unique de 30% (PFU composé de 12.8% d’impôt sur le revenu et de 17.2% de prélèvement sociaux), ce qui est généralement plus favorable que les tranches marginales d’imposition du barème progressif. A noter qu’il est également possible d’opter pour une taxation au barème progressif de l’IR après abattement de 40%.
Autre point d’attention : le passage d’une entreprise individuelle à une société nécessite la transmission du patrimoine professionnel de l’une à l’autre. Ce patrimoine s’entend du fonds de commerce, des dettes, des créances et du local d’exercice. Par exemple, le fonds de commerce pour un avocat est constitué par sa clientèle. Cette dernière peut être apportée ou cédée en pleine propriété à la société nouvellement créée.
Pour vulgariser, nous pourrions dire qu’il s’agit ici de doter la société d’un outil de travail. Soit elle le reçoit dans le cadre de votre apport, soit elle vous le rachète.
Les conséquences du choix sont importantes : l’apport permettra d’augmenter le capital social et d’optimiser la distribution de dividendes sur le plan social (lorsque ceux-ci représentent moins de 10% du capital social, ils sont soumis aux prélèvements sociaux de 17.2%. Au-delà, vous retournez sur le système de cotisation sociales des travailleurs non-salariés).
Une fois la valorisation de cette clientèle réalisée, la cessation de l’activité en nom propre permettra de calculer un impôt sur la plus-value. Dans le cadre de l’apport de la clientèle à la société, vous pourrez bénéficier du mécanisme de report. Dans le cadre de la cession, la plus-value professionnelle subira un taux d’imposition de 30% (pour les clientèles de plus de 2 ans).
Enfin, la cession de la clientèle à la société nécessitera que cette dernière s’endette.
En synthèse :
-match BNC / dividendes : difficile à trancher sans étude approfondie
-sur les cotisations sociales : potentiellement moins importantes avec la société mais dépend de type et du montant de la rémunération. Attention toutefois : moins de cotisation = moins de protection. Des mesures devront être prises en parallèle pour maintenir un bon niveau de protection sociale.
L'avis d'Indépat
Avant de vous lancer, posez vous les bonnes questions : suis-je prêt à réaliser des opérations complexes pour changer de statut? Ai-je bien pris conscience des implications et des coûts du passage en société ? Les revenus que j’ai tiré de mon activité professionnelle sont-ils pérennes ou étaient-ils exceptionnels?
Autant de questions qui peuvent vous conforter dans l’idée de solliciter une étude approfondie de votre situation pour déterminer la stratégie la plus adaptée.
Une étude patrimoniale sur ces sujets peut être couteuse, il est donc nécessaire avant toute chose de s’assurer de son opportunité. Votre conseil doit être en mesure de le déterminer avant de vous proposer une étude.
Les clés d'une étude patrimoniale efficace
- Analyser votre profil et vos objectifs
- Analyser votre situation personnelle et professionnelle
- Déterminer l'opportunité de l'intervention
- Faire intervenir les bons experts
- Présenter différents scénarios pour vous aider à la décision
- Debirefing et échanges pour une bonne compréhension
Prenons le temps d’en discuter lors d’un rendez-vous